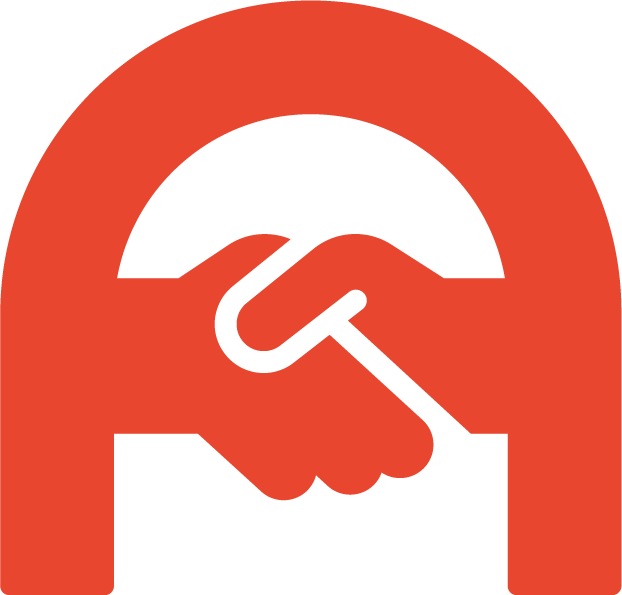La notion de « vice caché » revisitée
La Cour Supérieure du Québec a « revisité » à nouveau, récemment (le 3 mai 2012), l’ensemble des notions et critères applicables en matière de vice caché.
Il s’agit de l’affaire Légère c. 131666 Canada Inc., rapportée à 2012 QCCS 1850, sous la plume de l’Honorable Pierre Isabelle.
Dans cette affaire, les demandeurs sont les propriétaires d’un immeuble situé à Gatineau et ayant été acheté de Diane Robidoux le 31 juillet 2007.
L’une des particularités de cette affaire (et nous y reviendrons) tient au fait que les demandeurs ne poursuivent pas leur venderesse, Diane Robidoux, la mère de l’un des demandeurs, mais plutôt l’auteur de celle-ci, en l’occurrence la société 131666 Canada Inc.
Les demandeurs allèguent plus particulièrement que l’immeuble est affecté de vices cachés importants et ils réclament des dommages et intérêts à cet effet.
Aussi (autre fait particulier), le tribunal retient que la défenderesse 131666 Canada Inc. possède le statut de vendeur professionnel, suivant les dispositions du Code civil du Québec (le « C.c.Q. »).
En effet, il ressort clairement de la preuve que la défenderesse est une société dont la principale activité est d’acheter, réparer et revendre à profit des édifices résidentiels. Ainsi, de 1985 à 2012, cette société a acheté et revendu près de 250 immeubles dans la région de l’Outaouais.
Un dénommé Normand Blanchard est le seul actionnaire et dirigeant de la société défenderesse. De surcroît, ce type bénéficie d’une longue expérience dans le domaine de la construction et de la rénovation d’immeubles et il prétend jouir d’une très bonne réputation dans le cadre des activités commerciales de son entreprise. Il dit toujours agir de façon prudente lors de l’achat d’immeubles en les inspectant lui-même ou en demandant l’aide d’experts pour en examiner les composantes, lorsque cela dépasse le cadre de ses connaissances.
Les réparations, améliorations et embellissements des propriétés ainsi effectués par la société défenderesse sont habituellement réalisés en sous-traitance ou par des ouvriers à l’emploi de la défenderesse.
Il est également intéressant de retenir que le tribunal a retenu la responsabilité de la société défenderesse à l’égard des vices cachés dont l’immeuble était affublé, et ce, en dépit du fait que la vente de cet immeuble s’est faite sans garantie légale.
Ainsi, le tribunal a appliqué à la lettre l’article 1733 du C.c.Q., lequel prévoit que :
« Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien. Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel » (nos soulignements).
Aussi, dans cette affaire, les demandeurs bénéficiaient de la présomption prévue à l’article 1729 du C.c.Q., lequel se lit comme suit :
« En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. » (nos soulignements)
Ce dernier article fait donc apparaître clairement, en droit québécois, une présomption quant à l’existence du vice, lorsque la vente est faite par un vendeur professionnel. Par conséquent, étant donné qu’un vendeur est considéré comme un vendeur professionnel à l’égard des biens qu’il a l’habitude de vendre, c’est le vendeur professionnel qui devra prouver que l’immeuble n’était pas affecté de défauts cachés lors de la vente ou que ce défaut résulte d’une cause ultérieure à celle-ci.
Par conséquent, pour réussir dans le cadre de leur recours basé sur la garantie légale de qualité, les demandeurs devaient démontrer par prépondérance de preuve, et avec l’aide de la présomption précitée, les éléments suivants : a) le vice est grave; b) le vice leur était inconnu au moment de la vente; c) le vice est caché; et d) le vice est antérieur à la vente.
Après avoir analyser l’ensemble de la preuve, le tribunal a répondu par l’affirmative en ce qui a trait à chacun de ces éléments.
Comme nous l’avons évoqué plus haut, cette affaire présentait une particularité, lorsqu’on la compare à la plupart des recours exercés en matière de vices cachés par un acheteur contre son vendeur. En effet, dans cette affaire, l’action fût intentée par le sous-acquéreur de l’immeuble, à l’encontre de l’auteur de son vendeur. Le tribunal a rappelé que cela était possible en vertu des dispositions de l’article 1442 du C.c.Q., adopté à la suite de la décision de la Cour Suprême du Canada dans l’affaire General Motors Products of Canada c. Kravitz ([1979] 1 R.C.S. 790).
Cet article 1442 du C.c.Q. se lit plus particulièrement comme suit :
« Les droits des parties à un contrat sont transmis à leurs ayants cause à titre particulier s’ils constituent l’accessoire d’un bien qui leur est transmis ou s‘ils lui sont intimement liés»
En bref, le tribunal conclu que le recours direct de l’acquéreur d’un immeuble contre un vendeur précédent existe bel et bien en droit québécois; effectivement, ce recours permet à l’acquéreur de poursuivre, outre son vendeur, un vendeur antérieur, car les droits des parties à un contrat sont transmis à leur ayants cause à titre particulier s’ils constituent l’accessoire d’un bien qui leur est transmis ou s’ils lui sont intimement liés.
Il est intéressant de souligner que le tribunal précise que la présomption de l’article 1729 C.c.Q. bénéficie également au sous-acquéreur.